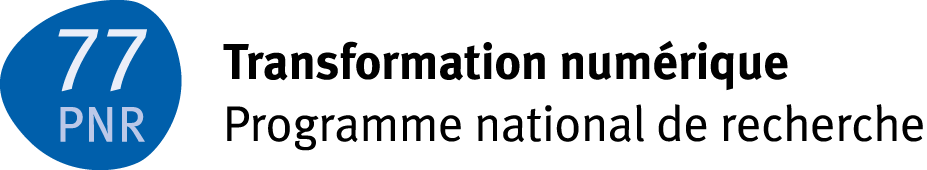Transformation numérique : la recherche impulse design, participation et régulation
Les travaux de recherche sont achevés. Manuel Puppis, professeur de politique des médias et de la communication revient sur le module 2 et salue la diversité et la pertinence des connaissances acquises.
Manuel Puppis est membre du comité de direction du PNR 77. En sa qualité de professeur de politique des médias et de la communication, il a contribué à l’évaluation des résultats de recherche du module 2. Cette interview lui a offert l’occasion de dresser un premier bilan: certains résultats se sont-ils révélés une surprise, d’autres voient-ils à l’inverse leur pertinence confirmée et que peut-on en déduire pour la politique et la société?
Professeur Puppis, les travaux de recherche du module 2 viennent de s’achever. Quelle impression d’ensemble vous ont-ils laissée?
Ce module était très riche de par son contenu. Des chercheuses et chercheurs issus de nombreuses disciplines se sont penchés sur les effets que le tournant numérique exerce tant dans le domaine public que dans la société et sur les défis que posent la conception et la régulation de l’IA et des algorithmes. Les projets ont apporté des réponses fondées et convaincantes aux questions qui avaient été formulées dans la mise au concours.
Quels sont les résultats ou les projets qui vous ont particulièrement marqué?
Plusieurs projets ont montré que les outils numériques étaient susceptibles de promouvoir la participation politique, notamment à travers de nouvelles formes de dialogue. L’influence de la sélection algorithmique en matière d’information de la population a également été étudiée de manière approfondie. Ce qui m’a notamment frappé c’est que le personnel médical comme les personnes ayant besoin de soins regardent souvent les technologies numériques comme de potentiels instruments de surveillance. Et aussi le fait que les questions relevant de la philosophie et de l’informatique nous incitent à revisiter nos attentes vis-à-vis de la technologie et à réfléchir à la meilleure manière de garantir équité et droits fondamentaux.
Certains résultats vous ont-ils surpris?
Oui, le fait que d’un point philosophique, il ne s’agit pas de savoir si l’on peut faire confiance à la technologie, mais plutôt de s’assurer de sa fiabilité. Un projet portant sur les soins dispensés aux personnes âgées a également mis en lumière que les seniors utilisent vraiment les outils numériques de façon très variée, alors cet élément est souvent sous-estimé ou peu différencié.
Quelle signification les résultats obtenus ont-ils pour la politique, l’économie et la société?
De nombreux projets ont fourni des recommandations concrètes à même d’impulser la conception et la régulation future de ces technologies. Les communes, les cantons et la Confédération pourraient notamment s’en saisir activement en recourant à des plateformes de dialogue numériques. Par ailleurs, des équipes ont développé des outils axés sur la pratique – par exemple afin de s’assurer de l’équité des algorithmes.
Leurs résultats seront publiés dans le courant de l’année sur les sites Internet des différents projets. Le comité de direction travaille parallèlement à l’élaboration d’une synthèse qui résumera les connaissances générées par le programme dans son ensemble. Celle-ci devrait être publiée à la mi-2026.
Module 2 «Éthique fiabilité et gouvernance»
Ce module a pour but de mieux comprendre comment la transformation numérique influence le concept de comportement éthique au sein de la population (au niveau individuel et sociétal). Il cherche à démontrer comment la numérisation modifie les rapports de confiance, et comment elle peut être appréhendée de manière à profiter aux individus comme à la société, tout en préservant fiabilité, valeurs sociales et droits fondamentaux.